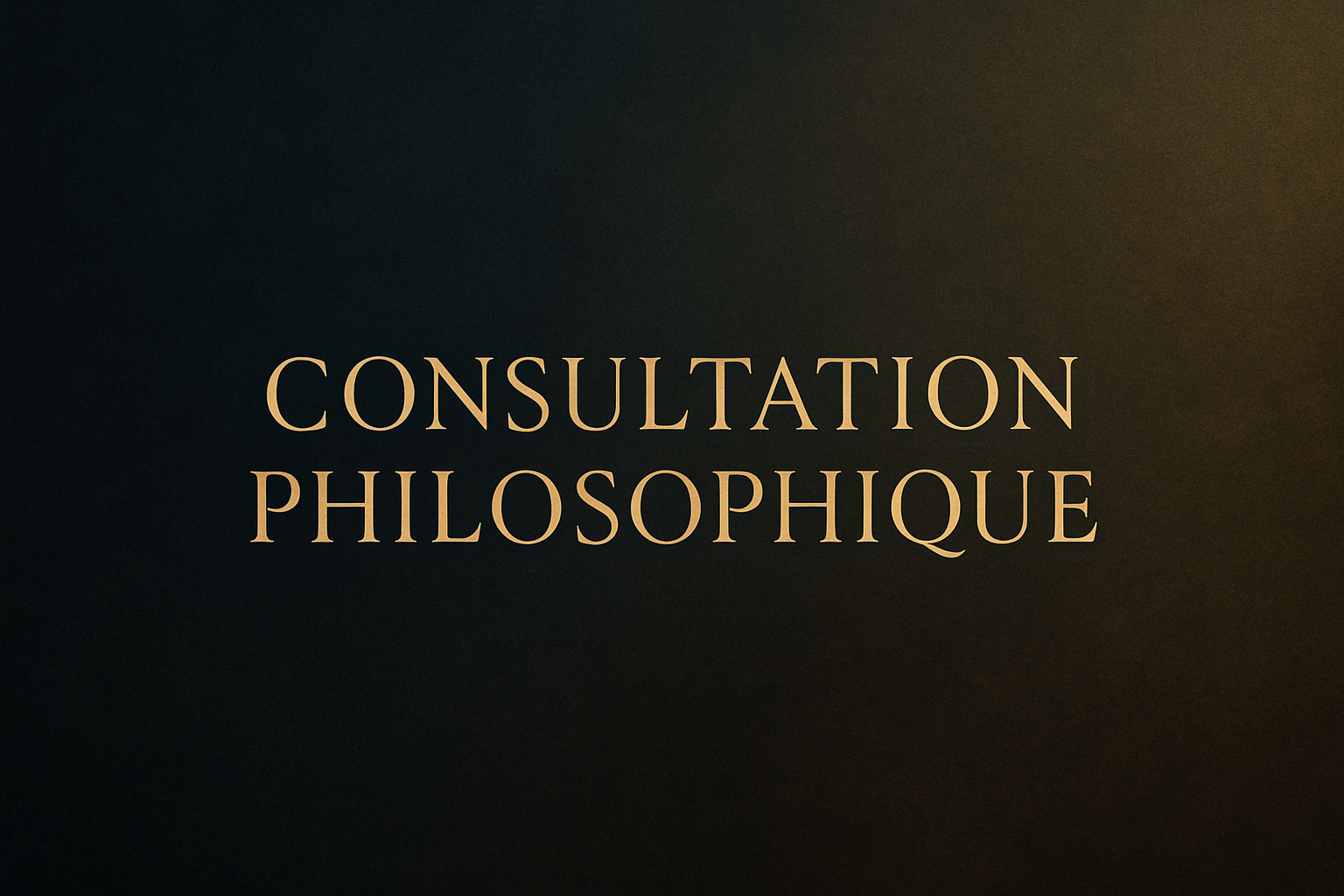La consultation philosophique, c’est quoi ?
Depuis 2021
I. Penser contre soi-même : l’exigence de la consultation philosophique
La consultation philosophique ne doit pas être confondue avec une consultation chez le psychologue. Ce qui se joue dans une telle rencontre est d’un tout autre ordre. Le psychologue travaille généralement à partir des affects, des blessures du passé, des conflits familiaux ou intérieurs. Son objectif est souvent thérapeutique : il s’agit d’aider la personne à aller mieux, à s’adapter, à retrouver un équilibre. Cela peut impliquer un travail d’écoute bienveillante, l’exploration d’une histoire personnelle, la mise à jour d’un traumatisme ou la restructuration de certains comportements ou représentations.
La consultation philosophique, elle, ne repose ni sur un diagnostic, ni sur un traitement. Elle ne suppose pas que la personne qui consulte est malade ou en déséquilibre. Elle ne vise pas non plus le bien-être comme finalité première. Elle s’intéresse à autre chose : à ce que dit le sujet, à la manière dont il le dit, et à ce que cela signifie au-delà de ce qu’il croit en dire. C’est là que réside sa spécificité.
Celui ou celle qui vient consulter est porteur d’un langage qui le dépasse. Ce langage, ce sont les mots qu’il emploie, les tournures de phrases, les expressions toutes faites, les valeurs implicites, les jugements spontanés, les hésitations, les formulations vagues ou maladroites, les silences aussi. Tout cela parle, tout cela signifie. Mais souvent, le sujet n’en a pas conscience. Il croit que ses mots lui appartiennent, alors qu’ils le traversent. Il croit que ses idées sont les siennes, alors qu’elles sont souvent héritées, conditionnées, reproduites sans examen. La consultation philosophique est donc ce lieu rare où l’on interroge la parole, non pas pour interpréter à la place du sujet, mais pour faire émerger ce qui se joue en lui sans qu’il l’ait encore pensé.
Dans ce cadre, penser ne consiste pas à émettre une opinion, encore moins à raconter son histoire. Penser, c’est d’abord se demander d’où viennent les pensées que l’on croit avoir. C’est prendre conscience que nos jugements ne sont pas neutres. Ils sont le produit de notre éducation, de notre milieu social, de nos habitudes, des discours ambiants, des images que nous avons reçues, des valeurs intériorisées. La philosophie invite à suspendre cette spontanéité de jugement pour interroger les présupposés : qu’est-ce que j’entends par « amour » quand je dis que je n’aime plus quelqu’un ? Que signifie « réussir sa vie » dans ma bouche ? Pourquoi est-ce que j’emploie sans y penser des expressions comme « être soi-même », « vivre pleinement », « avoir le bon timing » ?
Ce travail suppose une exigence forte sur le langage. Il faut prendre au sérieux les mots que l’on utilise. Cela signifie apprendre à les définir, à les distinguer, à repérer les confusions qu’ils véhiculent. Par exemple, beaucoup de personnes disent ne pas comprendre pourquoi elles ne se sentent pas heureuses alors qu’elles vivent une vie pleine de plaisirs. Elles confondent bonheur et plaisir. Ou bien elles s’imaginent qu’elles manquent de liberté, alors qu’elles refusent toute contrainte. Là encore, la confusion entre liberté et absence de limite empêche de penser juste.
Mais il ne s’agit pas seulement de clarifier les concepts. Il s’agit aussi de se situer dans un monde, de comprendre que ce que l’on vit ne nous appartient pas entièrement. Le consultant n’est pas un atome isolé. Il est pris dans des rapports sociaux, dans des héritages familiaux, dans des structures de pensée qui le dépassent. La consultation philosophique, en ce sens, vise à déplier ces déterminations. Elle invite à penser le singulier à partir de l’universel, et l’universel à partir du singulier. Elle ne dissout pas l’expérience individuelle dans des généralités, mais elle permet de la comprendre autrement, en l’inscrivant dans une histoire plus vaste : histoire des idées, histoire sociale, histoire symbolique.
C’est là qu’intervient une dimension essentielle et souvent méconnue : la symbolique. Le symbole n’est pas un simple ajout subjectif à une réalité neutre. Il est constitutif du réel. Ce que nous appelons « réel » est toujours déjà symbolisé. Il est structuré par des mots, des récits, des représentations qui organisent notre perception et notre rapport au monde. Ne pas en tenir compte, c’est passer à côté de ce qui nous fait agir, désirer, souffrir ou nous réjouir. La consultation philosophique prend cette dimension au sérieux. Elle n’oppose pas le symbolique au rationnel. Au contraire, elle cherche à penser le symbole, non comme un voile qu’il faudrait arracher, mais comme une médiation à comprendre. Ce que Freud a fait à sa manière en parlant du rêve comme réalisation symbolique d’un désir inconscient, ou ce que Godelier a montré dans ses analyses anthropologiques sur l’imaginaire et la structure sociale. Il a su montrer que l’idéel n’est pas seulement une représentation du réel, il en fait partie, et il en est une des formes constitutives les plus agissantes. Ce qui signifie que le symbolique ne se contente pas d’exprimer des rapports sociaux ou biologiques : il les structure, les autorise, les rend pensables et opérants. La frontière entre réel et imaginaire n’est donc pas donnée d’avance : elle est produite historiquement, à travers des formes symboliques incorporées, ritualisées, transmises, qui ont des effets matériels mesurables dans les corps, les gestes, les émotions et les institutions.
Ainsi, ce que le symbolique institue, le corps le confirme. Le deuil, la honte, la filiation, la maladie, la transe ou la fertilité ne sont pas des faits biologiques en soi, mais des états traversés, configurés, régulés par un ordre de sens, souvent véhiculé par le langage, les mythes, les rituels, les récits et les prescriptions culturelles. L’efficacité d’un soin, dans cette optique, ne tient pas seulement à une cause matérielle, mais à sa capacité à inscrire le corps dans une structure symbolique qui rend pensable une transformation.
La philosophie, ici, ne se retire pas du monde sensible : elle y plonge. Mais elle y plonge avec des instruments conceptuels, avec des exigences de clarté, avec une visée de vérité. Elle ne donne pas des conseils. Elle ne fournit pas des solutions. Elle invite à la lucidité. Et cette lucidité peut parfois produire un trouble, une résistance, une crise. C’est pour cela qu’on ne vient pas en consultation philosophique comme on va chercher un soulagement. On y vient pour travailler. Pour mettre à jour ce qui, en nous, cherche à se dire sans y parvenir. Pour reprendre le langage en main. Pour redevenir sujet de sa parole.
Ce n’est pas un exercice de développement personnel, ni une recherche de mieux-être immédiat. C’est un chemin de vérité. Et parfois, la vérité est plus exigeante que le confort. Mais elle rend plus libre. Parce qu’elle nous libère des fictions dans lesquelles nous nous enfermons, même inconsciemment. La consultation philosophique est donc un lieu rare : un lieu de reprise de soi, dans et par le langage, au croisement du symbolique, de l’existentiel et du rationnel.
La consultation philosophique est donc un lieu rare : un lieu de reprise de soi, dans et par le langage, au croisement du symbolique, de l’existentiel et du rationnel. Mais il serait trompeur de la présenter comme un espace confortable, doux, ou simplement bienveillant au sens ordinaire du terme. Car si elle est bienveillante, elle l’est dans un sens exigeant : elle veut le bien du sujet, mais un bien plus profond que le soulagement immédiat ou la pacification apparente. Elle vise un dévoilement. Et ce dévoilement est souvent difficile.
Apprendre à se connaître soi-même, comme le recommandait Socrate, n’est pas un chemin tranquille. La maïeutique, dont il est la figure fondatrice, est une pratique rude. Il s’agit de faire accoucher un sujet d’une vérité qu’il porte en lui sans le savoir. Or accoucher, symboliquement comme physiquement, n’est pas sans douleur. Dans une consultation philosophique, il est fréquent que le sujet se trouve confronté à ses propres contradictions, à ses automatismes de pensée, à ses justifications toutes faites. Il peut alors ressentir du trouble, du refus, de la colère. Ce n’est pas un signe d’échec, mais au contraire un signe que le travail commence. On n’aime pas toujours être ramené à ses incohérences, à ses schèmes répétitifs, à ses formules automatiques. On résiste à se voir soi-même autrement que dans le miroir familier de son récit.
Cette résistance est naturelle. Elle ne doit ni être jugée, ni renforcée. Mais elle doit être traversée. Et cela suppose une méthode. Contrairement à la posture d’« écoute flottante » que l’on trouve parfois en psychanalyse ou dans certaines pratiques psychologiques, la consultation philosophique ne laisse pas le sujet dérouler de longs monologues. Elle n’installe pas une scène où l’on pourrait rejouer sans fin son récit de soi, à l’abri de toute contradiction. Elle ne laisse pas se déployer ces discours saturés, ces phrases toutes faites que l’on a pris l’habitude de répéter comme une auto-analyse rassurante : « on m’a toujours dit que j’étais comme ça », « je pense que j’ai besoin de prendre du temps pour moi », « je veux être aligné avec moi-même ». Ce type de discours n’est pas ici rejeté par principe, mais il est interrogé, stoppé, déconstruit.
Dans une consultation philosophique, on coupe la parole. Non pas pour humilier, mais pour faire surgir une pensée vivante. On s’arrête sur un mot. On questionne une phrase. On relève une contradiction, un flou, une hésitation. On ne laisse pas filer les justifications qui servent à se protéger d’un vrai travail de pensée. Il ne s’agit pas d’écouter passivement, mais d’exercer une attention active, incisive, rigoureuse. Le philosophe ici ne se place pas en surplomb, mais il prend au sérieux le langage comme lieu du vrai et du faux, du sens et du leurre. C’est ce qui rend ce type de consultation profondément différent des pratiques thérapeutiques classiques. Il ne s’agit pas de donner du sens à tout prix, mais de mettre en question le sens même.
Un autre point fondamental distingue cette démarche : le sujet n’est jamais considéré comme une psyché isolée, un moi séparé du monde. Il est toujours déjà pris dans une histoire, dans une langue, dans des rapports sociaux, dans une culture. La philosophie, à la différence de nombreuses approches psychologiques, refuse de réduire la complexité humaine à des schémas intrapsychiques. Elle prend en compte la totalité dans laquelle le sujet s’inscrit : son histoire familiale, ses conditions sociales, les discours qu’il a intégrés, les rôles qu’on lui a assignés, les luttes de classe invisibles qui traversent ses décisions. Cela ne veut pas dire que le sujet est déterminé mécaniquement par son environnement. Cela veut dire qu’il ne peut être compris qu’à travers une dialectique entre ce qu’il vit et ce qui le traverse, entre ses expériences et les structures dans lesquelles elles prennent sens.
La consultation philosophique est donc un lieu de désenchantement et de lucidité. Elle vient déranger, déplacer, défier les certitudes. Elle refuse les simplifications psychologisantes comme les réductions purement subjectives. Elle ne cherche pas à consoler, mais à faire penser. Et penser, ici, c’est entrer dans une zone de trouble, d’incertitude, mais aussi de transformation possible. C’est comprendre qu’aucun mot ne va de soi, que chaque idée a une histoire, que le sujet que je suis est à la fois un corps, un nom, un passé, un désir, une position dans le monde, un héritier de traditions, un lieu de conflit et de possible.
En somme, il ne s’agit pas de s’allonger sur un divan pour se raconter, mais de se tenir debout dans un dialogue qui exige. Il ne s’agit pas de répéter un récit de soi, mais de le confronter. Il ne s’agit pas de se chercher, mais de commencer à se trouver — par le détour de la pensée, du mot juste, de la remise en question. C’est un chemin de vérité, exigeant, mais libérateur. C’est un travail, au sens fort du terme.
La différence majeure avec la psychanalyse est que je ne vous demanderai pas de parler longuement, de vous raconter, ni de chercher dans votre passé les causes inconscientes d’un mal-être. La parole n’est pas ici un flot à déverser, mais un outil à manier avec rigueur. C’est le philosophe qui mène l’interrogation. L’objectif est de penser contre soi-même, de dévoiler les contradictions dans nos manières de penser, de redonner un sens aux mots que nous utilisons sans y réfléchir.
La consultation philosophique s’adresse à toute personne traversée par une question existentielle, un tiraillement intérieur, un sentiment d’incohérence, sans pour autant s’inscrire dans un cadre pathologique. Elle vise à rétablir une cohérence par la raison, non à réparer un symptôme par un récit.
La différence majeure avec la psychanalyse, par exemple, est que je ne vous demanderai pas de parler longuement, de vous raconter, ni de chercher dans votre passé les causes inconscientes d’un mal-être – du moins si c’est un point de départ, ce n’est qu’un commencement et non la finalité du travail. La parole n’est pas ici un flot à déverser, mais un outil à manier avec rigueur. C’est le philosophe qui mène l’interrogation. L’objectif est de penser contre soi-même, de dévoiler les contradictions dans nos manières de penser, de redonner un sens aux mots que nous utilisons sans y réfléchir.
La consultation philosophique s’adresse à toute personne traversée par une question existentielle, un tiraillement intérieur, un sentiment d’incohérence, sans pour autant s’inscrire dans un cadre pathologique. Elle vise à rétablir une cohérence par la raison, non à réparer un symptôme par un récit.
II. Une méthode.
L’objectivité dans le monde humain ne peut pas être comprise comme l’effacement complet de la subjectivité, à la manière des sciences de la nature. Dans les affaires humaines, l’observateur est toujours partie prenante : il parle la langue des acteurs, partage leurs catégories mentales et appartient aux mêmes structures symboliques. Vouloir se placer « hors du jeu » est illusoire. Mais cela ne signifie pas que toute vérité soit impossible ou que tout point de vue se vaille : il est possible d’objectiver, c’est-à-dire de transformer un vécu singulier en un énoncé qui dépasse les circonstances et la subjectivité initiales.
La consultation philosophique offre un cadre privilégié pour ce travail, précisément parce qu’elle assume cette imbrication entre sujet et objet, tout en disposant d’outils pour la dépasser. Le sujet arrive avec un problème qui le concerne directement : un conflit professionnel, une question affective, un choix de vie. Il est donc impliqué émotionnellement et, à première vue, peu apte à juger avec distance. Mais la méthode philosophique consiste à faire travailler cette implication plutôt qu’à la nier.
La première étape est la division : découper le problème en ses éléments constitutifs, clarifier les termes, isoler les présupposés implicites. Dire « je suis malheureux » devient : « Je dis être malheureux parce que je me sens inutile ; j’entends par “utile” apporter une aide concrète ; or mon travail ne me donne pas cette perception. » Cette clarification enlève déjà une part de flou émotionnel et prépare le terrain pour un examen rationnel.
Vient ensuite la maïeutique : par un questionnement méthodique, le philosophe amène le sujet à éprouver la solidité de ses affirmations. On teste la définition avancée sur des cas différents, on observe si elle résiste ou si elle se contredit. Ce processus n’impose pas une réponse extérieure ; il oblige le sujet à reformuler sa pensée jusqu’à ce qu’elle gagne en cohérence. C’est ainsi que, même en restant partie prenante, il peut produire une formulation plus stable, moins dépendante de l’affect immédiat.
La dialectique joue ici un rôle central : elle met en tension les affirmations et leurs contraires, explore les conséquences de chaque position, ouvre des perspectives que le sujet n’aurait pas envisagées seul. Ce n’est pas un simple échange d’opinions, mais une confrontation réglée qui pousse les idées jusqu’à leurs limites. Le but n’est pas de « gagner » une discussion, mais de transformer le problème en une question universalisable.
Car le travail philosophique vise précisément ce passage : du particulier à l’universel. L’exemple vécu devient l’illustration d’une structure plus générale : la peur de l’échec public, le conflit entre liberté et sécurité, la tension entre plaisir immédiat et bonheur durable. Une fois replacée dans cette trame commune, la situation perd de son caractère purement privé : elle devient intelligible pour d’autres, et donc discutable selon des critères partagés.
Ce cheminement suppose l’honnêteté du sujet : accepter d’être déplacé, d’examiner ses idées sans se protéger derrière des justifications hâtives. Mais il ne repose pas sur la sincérité seule : c’est la méthode – division, maïeutique, dialectique – qui garantit que l’analyse ne se contente pas de refléter l’humeur du moment. Chaque étape oblige à formuler, confronter, reformuler, jusqu’à atteindre un énoncé qui pourrait valoir pour quiconque placé dans une situation comparable.
Ainsi, même lorsqu’il est juge et partie, le sujet peut atteindre une forme d’objectivité : non pas une vérité absolue, mais une formulation universalisable de son problème, dégagée de ses seuls affects et insérée dans un horizon de compréhension commun. L’objectivité, dans ce sens, n’est pas l’absence de subjectivité ; c’est sa transformation, par le dialogue méthodique, en un savoir partageable.
III. Et en vidéo : En quoi consiste la consultation Philosophique ? A qui s’adresse-t-elle ? (2021)
En savoir davantage encore sur la pratique philosophique en consultation :